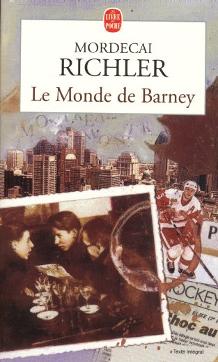
|
Je n’avais pas remporté des lauriers à McGill comme Terry, ni fréqunté Harvard ou Columbia à l’ instar d’autres membres de notre bande. Non, je m’étais contenté de subir le lycée, dont les cours m’intéressaient bien moins que les billards de l’académie royale du même nom où je disputais des parties de « snooker » avec Duddy Kravitz. L’écriture n’est pas mon fort, la peinture non plus. Aucune ambition artistique, donc, à moins de désigner comme tel ce rêve que je caressais de devenir chanteur et danseur de music-hall, agitant mon canotier à l’adresse des braves gens au balcon tout en m’esquivant élégamment avec force claquettes pour céder la place à Peaches, à Anne Corio, à Lili Saint Cyr ou quelque autre danseuse exotique » dont le numéro culminerait en une extase de tambours effrénés donnant aux spectateurs l’occasion d’apercevoir un éclair de sein nu, Montréal restant alors à des années-lumières des bars topless.
Certes, j’étais un lecteur acharné, mais vous auriez tort de voir là une preuve de bonne éducation, ou de sensibilité. En réalité, je dois reconnaître, avec un clin d’œil Clara, la fondamentale indignité de ma personne. Mon détestable esprit de compétition. Car ce qui m’emballait ce n’était pas Tolstoï et son Ivan Illitch, ni Conrad et son agent secret, mais la lecture de Liberty ce bon vieux magazine qui avait la particularité de faire précéder chacun de ses articles d’une estimation du temps qu’il fallait pour le lire. Cinq minutes et trente-cinq secondes, par exemple. Alors, posant ma montre Mickey Mouse sur la toile cirée à carreaux de notre cuisine, je dévorais le papier en question et, arrivé, au bout en quatre minutes trois je me faisais l’effet d’un intellectuel accompli. Après Liberty, je passai à la classe supérieure en l’espèce d’un roman à quatre sous, Mister Moto de John Marquand, disponible à l’époque chez Jack & Moe, le salon de coiffure au coin de Park Avenue et de Laurier, en plein cœur du quartier juif prolétarien de Montréal où j’ai grandi. Cette vieille zone urbaine, la seule circonscription canadienne de l’Histoire à avoir un communisme au Parlement— Fred Rose-, a aussi été le berceau de deux boxeurs passables— Louis Alter et Maxime Berger-, de la cohorte habituelle de médecins et de dentistes, d’un célèbre directeur de casino, d’une pléthore d’avocats sans foi ni loi, d’anonymes instituteurs comme de milliardaires du schmatt, de quelques rabbins et d’au moins un assassin présumé : moi.
Je me souviens du congrès de près de deux mètres s’accumulant autour de perrons qui devaient être nettoyés à la pelle dans un froid polaire.
|
|
Tout est à cause de Terry. Il est l’aiguillon. L’écharde plantée sous mon ongle. Je le dis clair et net : si je m’aventure dans cette pagaille, dans ce ratage qu’est la véritable histoire de ma vie, si je bafoue toutes mes résolutions en gribouillant un premier livre à un âge aussi avancé, c’est uniquement pour répondre au venimeuses calomnies que Terry McIver répand dans autobiographie à paraître. À mon propos comme au sujet de mes trois femmes— connues aussi sous le sobriquet de « la troïka de Barney Panofsky » - , de la nature de mon amitié avec Boogie et, bien entendu, du scandale que je me coltinerai telle une bosse dans le dos jusqu’à la tombe. Le temps et ses fièvres, son cataplasme de livre doit être incessamment lancé sur le marché par The Group (pardon, the group), une petite maison d’édition de Toronto qui vit de subventions publiques et commet aussi un mensuel, Sauver la Terre, imprimé vous pouvez en être certains, sur papier recyclé.
Tous deux enfants de Montréal, Terry McIver et moi nous étions retrouvé à Paris au début des années cinquante. Le malheureux n’était qu’à peine toléré dans mon milieu, un harde de jeunes écrivains sans un sou mais couverts de lettres de refus d’éditeurs, chauds lapins et optimistes patentés pour qui tout semblait à portée de la main, la célébrité, les admiratrices pâmées, la fortune guettant patiemment au coin de la rue à l’instar de ce camelot légendaire de ma jeunesse qui d’après la rumeur vous arrêtait sur le trottoir et se faisait fort de vous donner un billet de un dollars tout neuf en échange de chewing-gum Wrigley si vous en aviez un dans votre poche évidemment. Mais alors que je ne suis jamais tombé sur le généreux envoyé de William Wrigley Jr, empereur du chewing-gum, la célébrité allait en effet croiser la route de certains d’entre nous : le très inspiré Léo Bishinsky, Cédric Richardson— quoique sous un autre nom— et Clara bien sûr Clara qui jouit désormais d’une renommée posthume, celle de sainte patronne du féminisme, forgée sur l’enclume impitoyable du chauvinisme mâle. Mon enclume, en quelque sorte. J’étais une anomalie. Plus encore : une anomie. Moi, j’étais né pour faire des affaires. |
|
Drôle de vie que celle de Barney ! Barney Panofsky, juif canadien, expatrié dans les années cinquante à Paris, où il a côtoyé la bohème artistique. De retour au pays, il devient importateur de fromages français, puis producteur de télévision.
De ses trois épouses, la première, nymphomane, se suicidera. Il abandonnera la deuxième le jour même de leur mariage. Quant à la troisième, elle le quittera au bout de trente-six ans.
Accusé de meurtre d’un de ses copains, Barney finira solitaire et poivrot, laissant cette autobiographie. |
|
Autres pays |
|
Retour à la page d’accueil |